LA TRIBUNE - Vous créez Le Slip Français en 2011. Sur un pari. Vous vous lancez sur le Net, ce qui fait de vous une DNVB, une Digital Native Vertical Brand. Aujourd'hui vous réalisez 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous employez 120 salariés et disposez de 20 boutiques en France. Que s'est-il passé en dix ans ?
GUILLAUME GIBAULT - Beaucoup de choses. Nous avons porté ce que, aujourd'hui nous avons mis dans nos statuts d'entreprise à mission - et que nous tentons de faire tous les jours - réinventer avec panache l'industrie textile française. Nous fabriquons 600.000 vêtements par an auprès de 80 partenaires intégralement basés en France. On tricote et on tisse la matière, on confectionne... Nous faisons donc le plus Made in France possible. Nous essayons d'innover, d'aller encore plus loin avec des matières locales comme le lin, le chanvre, comme la matière recyclée. Nous mesurons l'impact carbone de tous les produits que nous fabriquons. Je donne un fait qui fonctionne pour tout le monde : un vêtement fabriqué en France c'est jusqu'à 50% d'émission carbone de moins qu'un vêtement fabriqué à l'étranger, et cela grâce au mix énergétique de la France, notamment le circuit court qui fait qu'un vêtement n'est pas fabriqué en Chine pour venir jusqu'en France. Nous nous sommes donnés beaucoup de mal pour émerger en tant que marque. Globalement, nous avons mené ce combat de redonner du bon sens à la fabrication d'un vêtement. Nous tous, en tant que consommateurs, avons des questions à nous poser : d'où viennent les vêtements que nous portons ? Pourquoi un t-shirt coûte-t-il 5 euros chez une marque de fash fashion ? Parce qu'il est fabriqué par un Bangladais à l'autre bout du monde, qui gagne quelques dollars par mois. Et quand on va sur le terrain de la morale, que l'on explique que ce n'est pas bien de le faire, ça ne fonctionne pas. Il faut au contraire proposer des alternatives désirables, qui entrent dans une démarche de mode, qui va donner envie au client de porter un produit qui est joli.
La crise sanitaire - qui a exigé des masques, des blouses... a été un moment de prise de conscience du manque de souveraineté de la France en matière textile.
Le Covid a été une tragédie sur plein d'aspects mais pour la filière textile cela a été une opportunité folle car elle s'est lancée dans la fabrication de masques. Cela a permis de remettre de la trésorerie chez certains ateliers textiles français. Je rappelle que 90% des emplois sont partis : 400.000 emplois dans le textile dans les années 90, 60.000 aujourd'hui. Grâce à la période Covid, beaucoup ont remis de la trésorerie dans les usines. A cela s'ajoute le plan de relance, extrêmement structuré, qui a financé 700 projets... Aujourd'hui nous disposons d'une filière textile qui a envie, qui dispose de nouvelles machines, assez innovante sur le recyclage, l'upcycling...
Aujourd'hui avec la hausse des prix de l'énergie, la hausse du coût du transport - un container qui effectuait le trajet de la Chine à la France c'était 2.500 dollars avant la crise, c'est 15.000 dollars désormais. Forcément, par t-shirt, ça rajoute pas mal d'euros... A cela s'ajoute le taux de change euro/dollar que l'on ne maîtrise plus, les salaires qui augmentent dans les pays à bas coût... Tout cela fait qu'aujourd'hui l'équation Made in France n'est plus tellement plus chère qu'ailleurs. Ce qu'il se passe, en plus de la charge environnementale qui arrive sur les vêtements, bientôt dotés d'étiquettes qui indiquerons un score A, B, C, D, E comme sur les appareils électro-ménagers - autant dire que le t-shirt fait en Chine sera dans mal noté - pousse à une volonté de relocaliser en France. La thèse macro-économique mondiale c'est qu'il faut produire localement et relocaliser. Ça fait dix ans que nous le faisons.
Le Made in France, c'est donc possible ?
Le Made in France, c'est possible. Il y a une équation simple : le SMIC français est à 1.500 euros. Le SMIC, ne serait-ce que portugais c'est 700 euros. Donc comme fabriquer un vêtement c'est du temps de main d'œuvre, le calcul est assez mécanique. Et comme il n'y a pas de SMIC au Bangladesh... l'équation est encore plus simple.
Le Made in France suppose d'avoir tous les maillons de la chaîne de fabrication d'un vêtement, sur le territoire. Il faut de la laine, il faut du fil... cela n'est pas toujours le cas. Vous souhaitez faire du Slip Français une plateforme qui permette - à l'instar du MaaS dans les transports - de faire de l'industrie as a service.
Nous avons en effet notre activité de marque BtoC, Le Slip français. Je suis bien conscient que lorsqu'on vend un sous-vêtement à 35 euros, on ne peut pas le vendre à tout le monde. Cette équation économique, je l'ai construite avec un modèle de marque, qui donne envie, qui raconte une histoire... Actuellement, avec tout ce que l'on vit, je pense que nous sommes capables d'industrialiser sur des gammes de produits beaucoup plus courtes et travailler avec une logique un peu différente. Si on aborde la grande distribution, par exemple, l'idée serait de travailler sur un t-shirt plus basique, en faire une seule référence, avec un grand volume. Nous allons accompagner les industriels dans l'achat des bonnes machines pour le faire, former le personnel et arriver à relocaliser avec l'impact carbone, l'impact sociétal qui va avec... Se donner bonne conscience en revendant ses vêtements sur des plateformes comme Vinted, ça n'est pas la solution. Vinted, ce n'est pas fait pour moins consommer mais pour revendre des vêtements et ainsi en acheter de nouveaux. Il faut trouver des alternatives pour fabriquer moins, pour fabriquer mieux. Être compétitifs en Made in France c'est la suite de notre mission d'entreprise. C'est la vision du marché. En parallèle de notre marque BtoC, nous accompagnons beaucoup d'autres acteurs.
Vous prévoyez de montrer l'usine textile du futur lors du salon Made in France, à Paris en novembre
En effet, nous avons réservé 1.400 m2 pour faire l'usine textile du futur, raconter toute la filière, avec le lin, le chanvre, nous allons montrer toutes les étapes de transformation, du champs jusqu'à la fibre dont on peut faire un fil, du recyclage, l'upcycling, la réparation, la production sur mesure, la coupe... raconter toutes les étapes d'un vêtement, montrer au grand public, de 7 à 77 ans que l'industrie est tout sauf morte et enterrée, montrer qu'elle innove, qu'elle est locale, capable de répondre à la demande. Peut-être que le vrai bon prix d'un t-shirt, c'est 25 euros et il est vrai qu'il faut gagner en compétitivité pour faire descendre ce prix qui n'est pas accessible pour tout le monde. Et se dire aussi que l'on a peut-être un peu moins besoin de t-shirt...
Vous n'aimeriez pas si on vous disait que l'on a moins besoin de sous-vêtements...
C'est pour cela que je travaille pour d'autres. Nous dépensons moins en marketing que ce nous avons pu faire au début, dans une logique très startup et très DNVB. Aujourd'hui, nous sortons de cela. J'ai envie de créer une PME, c'est sexy, la PME. Une PME innovante, ancrée dans les territoires, qui crée de l'emploi.
Quels sont les trous dans la raquette de la filière textile ?
Le trou principal est sur la filature. C'est la partie que nous n'avons pas réussi à bien relocaliser. Nous n'avons pas réussi à trouver l'équation économique. Certaines usines reviennent sur le lin, mais c'est le tout début. Il faut aussi être pragmatique, ne pas vouloir tout faire.
Le Slip Français dans dix ans, ce sera quoi ?
Il faudra que l'on ait réussi à installer une première plate-forme pilote, un Station F de la mode durable, qui incarne, qui montre que c'est possible. Et on sera en train d'en ouvrir dans d'autres villes de France.
Pour revoir l'interview de Guillaume Gibault, lors du Transition Forum, c'est ici
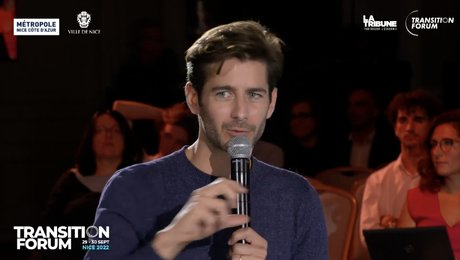

 Comment Microsoft et la Région Sud font de leur partenariat un accélérateur d'usage de l'IA
Comment Microsoft et la Région Sud font de leur partenariat un accélérateur d'usage de l'IA


Il n'y a actuellement aucun commentaire concernant cet article.
Soyez le premier à donner votre avis !